Le dernier jour d’un condamné, incipit (chapitre 1) : analyse
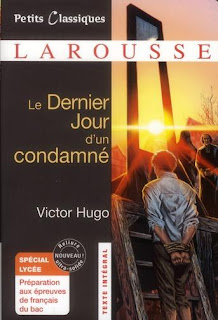 |
Le dernier jour d’un condamné, incipit (chapitre 1) : analyse |
Le dernier jour d'un homme condamné, éditorial (chapitre un), introduction
Victor Hugo a écrit Le dernier jour du condamné après avoir vu le bourreau sur la place de l'Hôtel-de-Ville en 1828 graisser la guillotine en vue de son exécution ce soir-là.
Ce roman se présente comme le journal d'un bagnard écrit durant les vingt-quatre dernières heures de son existence.
Cette approche romantique de l'histoire et de la justice est en rupture avec les théories pénales en vigueur à l'époque.
Par exemple, pour Diderot, philosophe des Lumières, « le malfaiteur est un homme qu'il faut détruire et non punir ». Pour Kant, la peine de mort permet de protéger le contrat social lorsqu'il est en colère.
Cependant, en 1764, sont publiés les crimes et châtiments commis par le juriste italien Cesare Beccaria, qui déclare la peine de mort « barbare » et propose de subordonner le droit au châtiment à la proportion des châtiments. Rapidement traduit en français, Crimes et Châtiments lança le mouvement abolitionniste dont Victor Hugo fut une voix retentissante en France.
Dans l'ouverture (chapitre premier) du Dernier jour d'un condamné, Victor Hugo raconte, dans une remarquable chronique (1), le destin tragique d'un homme (2) pour mieux présenter un réquisitoire contre la peine de mort (III).
Questions possibles à l’oral de français sur l’incipit (chapitre 1) du Dernier jour d’un condamné
♦ En quoi est-ce le début d'un acte d'accusation contre la peine de mort ?
♦ Qu'est-ce que Victor Hugo essaie de montrer dans le premier acte ?
Comment ce premier chapitre du dernier jour du forçat s'inscrit-il dans le récit tragique ?
♦ Ce réquisitoire contre la peine de mort est-il efficace selon vous ?
I – Un univers fantastique
A – Une représentation réaliste
L'installation dans le cadre spatial « Bicêtre » fait référence à la maison d'arrêt de Paris où ont eu lieu les premiers essais de la guillotine.
La première phrase, Nominal ("Doomed to die!"), adopte le point de vue du personnage, renforçant le réalisme de cette vision carcérale.
Le dossier factuel est accentué par les contrôles de temps « ici cinq semaines », « avant », « aujourd'hui ».
Dans le dernier paragraphe, les noms sont systématiquement identifiés par des adjectifs ou des noms complémentaires : « pensée meurtrière », « vérité terrible », « planche mouillée et moite », « rayons obscurs », « lampe de nuit », « cadre rugueux », « silhouette sombre ». « Soldat de la garde.
Avec ces qualifications, Victor Hugo propose la représentation la plus fidèle possible de la réalité à travers la qualification complète de chaque objet décrit. La terminologie est précise, voire technique comme "giberne".
B – Une scène irréelle
Mais Victor Hugo fait ressortir le réalisme de la scène pour mieux glisser vers le grand disque.
En effet, le condamné personnifie la mort : « sa présence », « face à face », « mains de glace », « toutes formes », « avec lui », « voix ».
La mort prend une dimension fantomatique (« existence », « sonore ») voire monstrueuse (« mains de glace »).
Même la mort équivaut à la forme légendaire de Protée autant qu'elle apparaît sous "toutes les formes".
La mort est également assimilée à travers le personnage tel qu'il est décrit dans le domaine lexical de l'imagination : « pensée », « âme », « imagination », « idée », « pensée », « âme », « obsession ».
Cette présence angoissante de la mort rend fou le condamné.
Ainsi, le champ lexical du rêve montre que le personnage est attiré par un monde où l'illusion se confond avec la réalité : « éveil », « sommeil convulsif », « mes rêves », « réveil », « rêver ».
Le verbe impersonnel « il me semble » confirme ce glissement dans le délire et la folie.
La vision douloureuse du personnage transforme la réalité qui l'entoure. Le champ lexical des couleurs ("pâle", "nuit", "sombre", "brillant") crée une image alarmante et fascinante du clair-obscur.
L'environnement du forçat devient brutal. "La clôture hideuse dans ma cellule" sonne comme le mot "griffe" sonne comme un monstre endormi.
Transition : Cell est un monstre, l'enfer comme en témoigne le champ lexical de l'horreur : "horreur", "sanglant", "infernal", "fantôme", "horrible refrain", "couteau", "terrible vérité", qui met le personnage dans une position tragique.
II – Un incipit tragique
A – L’enfermement du héros
Victor Hugo décrit l'enfermement du personnage dans un enfer carcéral.
Le champ lexical des familles montre l'enfermement tragique du personnage : « forçat », « captif », « fer », « cachot », « prison », « filets », « cachot ».
Cet enfermement physique est renforcé par l'enfermement grammatical : la phrase nominale « condamné à mort ! » Il ouvre le texte, se retrouve au centre du texte puis le referme, revivant ainsi l'enfermement.
Le texte est emprisonné sous cette phrase qui rappelle douloureusement la sentence du juge.
La triple cadence ("Seul avec elle, toujours figé par sa présence, toujours ployant sous son poids !", "Une idée horrible, sanglante, têtue !") crée un tragique effet circulaire comme si le personnage tournait indéfiniment dans sa cellule.
Le parallèle de construction « Mon corps dans un cachot dans un cachot, mon esprit dans une prison dans une idée » souligne que ni le corps ni l'esprit ne peuvent s'échapper.
La tournure restrictive de « J'ai une idée, une conviction, une certitude » montre le tragique rétrécissement de l'espace de vie de ce condamné.
III – Un réquisitoire contre la peine de mort
A – Une condamnation de la peine de mort
Le personnage de cet éditorial a été condamné à mort. Il ne cherche pas un nouveau procès ni à convaincre le lecteur de son innocence. Il mène un nouveau procès : celui de la peine de mort.
Sa façon de s'exprimer est proche du discours judiciaire.
Par exemple, le point d'exclamation "Doomed to die!" C'est un outil de prise de parole destiné à montrer l'énergie et la conviction de l'orateur.
Les rythmes aigus, nombreux dans ce chapitre 1, relèvent aussi de la rhétorique judiciaire.
La longueur des phrases divisées en périodes simule les élans de la pensée et du cœur : « Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un fantôme de plomb à mes côtés, solitaire jaloux, chassant toute distraction, et se retrouvant face à face. avec moi misérablement, me secouant de ses mains glacées quand je veux détourner la tête Ou fermer les yeux."
La pitié est accentuée par le drame créé par le dialogue fictif entre la mort et le personnage (« — Ah ! ce n'est qu'un rêve ! — OK ! »).
Il est intéressant de noter que la tragédie ici n'est pas due au crime commis par le condamné à mort mais à la peine de mort elle-même.
Ce coup d'état est un style rhétorique qui transforme ce texte en réquisitoire (= discours judiciaire accusatoire)
Par cette ouverture, Victor Hugo a montré que la peine de mort est brutale et contraire au principe d'humanité. La comparaison viscérale "j'étais un homme comme un autre" (= le narrateur dit deux fois la même chose) ramène la société à l'essence - l'humanité - dont se moque la peine de mort.
B – Une ode à la vie
Ce réquisitoire contre la peine de mort est d'autant plus efficace qu'il est assorti d'un poème sur la vie.
Victor Hugo utilise le disque lyrique pour souligner la beauté éphémère de la vie.
Le « je », « je », « je » à la première personne et la ressemblance du texte avec un journal intime nous plongent dans l'univers intérieur des bagnards.
L'opposition du « avant » et du « maintenant » temporaires contraste avec le ton élégiaque du deuxième paragraphe.
Les verbes imparfaits ("était", "était", "jouis", "étaient") renforcent cette impression de distance entre le monde carcéral et la vie.
En comptant, le personnage voit sa vie défiler devant ses yeux de façon précipitée : « Petites filles, magnifiques évêques, les batailles sont victorieuses, les théâtres sont pleins de bruit et de lumière, puis encore des jeunes filles brunes se promènent la nuit sous ses larges bras de des châtaigniers."
L'approximation aléatoire des événements (« sans ordre et sans fin », « et puis encore les petites filles ») traduit le caractère éphémère et fragile de la vie.
Le champ lexical de la fête ("fantasmes", "génial", "bruit et lumière", "petites filles") et "arabesques intarissables" recrée l'abandon de la jeunesse.
Le monde passé ressemble à un paradis perdu, comme le suggère l'absence de l'article « fête » qui rend la joie plus spontanée : « Ça a toujours été une fête dans mon imagination ».
Victor Hugo propose une musique festive et gaie :
L'harmonie en [é] met en évidence le caractère paradisiaque de ce monde perdu : "C'était toujours une fête dans mon imaginaire. Je pouvais penser ce que je voulais, j'étais libre"
♦ Chanter en [i] : « petites filles », « belles », « son et lumière, puis encore petites filles », « nuit ».
Le dernier jour du condamné Conclusion du chapitre 1
Derrière une peinture pathétique et tragique, Victor Hugo montre l'effacement de la vie, et le meilleur argument pour affronter la peine de mort est la négation de la vie.
Après cette ouverture rhétorique destinée à persuader le lecteur, Victor Hugo présentera l'exécution du personnage comme un ignoble spectacle.
Le dernier jour d'un condamné recevra un accueil mitigé, des écrivains comme Désirée Nisard restant "froids (durs) car cela ne ressemble à personne", et d'autres comme Sainte-Beuve s'enthousiasmant pour cette "anatomie grossière du cerveau de quelqu'un". condamné."
L'introduction par Hugo en 1832 du Dernier jour d'un condamné ainsi que la publication par Claude Jow en 1834 de l'ouvrage apportent la dimension dialectique et rationnelle qui sous-tendra le mouvement abolitionniste pour les siècles à venir.



